La question revient partout : est-ce que l’État pourrait vous mobiliser, vous personnellement, si la situation militaire dégénère en Europe ?
Est-ce que cela veut dire partir au front, être rappelé pour du soutien logistique, ou simplement être réquisitionné pour continuer votre métier, mais sans droit de refuser ?
À ce jour, en France, il n’existe pas d’appel automatique et généralisé des civils pour aller combattre.
Vous n’êtes pas envoyé “au front” du jour au lendemain parce que vous êtes un citoyen lambda.
En réalité, l’État suit un ordre précis : militaires d’active, réservistes, anciens militaires, puis, seulement ensuite, les civils nécessaires au fonctionnement du pays.
Ce n’est pas ce qu’on entend dans les discussions de comptoir, mais c’est comme ça que ça se passe dans les pays qui sont réellement en guerre aujourd’hui.
D’ailleurs, je vais essayer de m’appuyer au maximum sur les exemples récents de la guerre Ukraine-Russie, pour étayer mes propos…
- Qui part en premier si la France mobilise vraiment ?
- À quel moment vous devenez concerné, vous personnellement ?
- Est-ce que votre santé peut vous empêcher d’être mobilisé ?
- Âge, sexe : qui est d’abord visé par la conscription ?
- Réquisition civile : servir sans uniforme, est-ce possible ?
- Synthèse et conclusion
Qui part en premier si la France mobilise vraiment ?
En situation de guerre ouverte, un État moderne commence toujours par engager les forces déjà formées, encadrées et équipées.
Concrètement, on ne commence pas par envoyer des civils sans expérience : on commence par les forces actives, puis les réservistes, puis les anciens militaires avec expérience réelle du terrain.
Ce schéma n’est pas théorique, c’est par exemple exactement ce qui s’est passé en Ukraine après l’invasion russe en février 2022 et en Russie lors de la “mobilisation partielle” annoncée en septembre 2022.
1. Les militaires d’active
Les militaires d’active sont les forces déjà en service permanent (armée de terre, marine, armée de l’air, unités déjà opérationnelles et projetables).
Ce sont eux qui sont engagés en premier, parce qu’ils sont entraînés, équipés, commandés et immédiatement disponibles.
C’est ce qu’a fait l’Ukraine : les unités déjà actives et déployées ont été engagées immédiatement dès le 24 février 2022, avec instauration de la loi martiale et ordre de mobilisation générale.
En parallèle, l’Ukraine a interdit la sortie du territoire aux hommes en âge de servir afin d’assurer une base de renforts mobilisables derrière ces forces déjà actives.
2. La réserve opérationnelle
Deux types de profils sont mobilisés ici : les réservistes sous contrat et les anciens militaires encore “disponibles”.
En Russie, Vladimir Poutine a annoncé le 21 septembre 2022 une “mobilisation partielle” visant explicitement les réservistes et “avant tout ceux qui ont déjà servi dans les forces armées, qui ont une spécialité militaire et une expérience”.
Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a parlé de 300 000 personnes issues de ce vivier, en précisant que ce pool représentait des dizaines de millions d’anciens appelés/contractuels potentiels.
Côté ukrainien, les premières vagues ont d’abord rappelé les réservistes ayant déjà combattu dans le Donbass avant 2022, donc des gens avec une vraie expérience de terrain, puis seulement après des classes moins récentes.
Dans les deux cas, l’ordre logique est clair : on rappelle d’abord ceux qui savent déjà faire le métier.
3. Les anciens militaires avec compétences critiques
Après l’active et les réservistes “récents”, on va chercher les profils techniques déjà formés : transmissions, génie, maintenance d’équipements lourds, santé opérationnelle, logistique, conduite d’engins spécialisés.
En Ukraine, la loi de mobilisation prévoit explicitement que les mobilisés sont appelés par catégories en fonction de leur passé militaire, de leur spécialité et des besoins concrets (mécanique, soutien, santé, etc.).
En Russie, le discours officiel a été : nous mobilisons des gens qui ont “certaines spécialités militaires et une expérience pertinente”, pas des civils sans formation.
Traduction opérationnelle : même à 40 ou 50 ans, si vous êtes un ancien sous-officier transmissions ou un mécano blindé qualifié, vous êtes jugé plus utile immédiatement qu’un civil de 22 ans sans formation militaire.
4. Les soutiens indispensables à l’arrière (logistique, santé, énergie, transport)
Ici on parle des gens qui ne vont pas forcément en première ligne, mais sans qui l’effort militaire s’écroule : soignants, mécaniciens, conducteurs poids lourd, opérateurs réseaux énergie/eau, spécialistes transmissions, maintenance d’infrastructures critiques, etc.
Concrètement, cela veut dire que des civils restent à leur poste “civil”, mais ce poste devient une mission de défense nationale, avec obligation de continuer à faire tourner le réseau électrique, l’eau potable, les transports, les hôpitaux, les ateliers de maintenance, etc.
En parallèle, l’Ukraine a vu émerger une “armée invisible” de soutien : bénévoles, ateliers locaux, réseaux logistiques citoyens qui fabriquent des filets de camouflage, livrent du matériel, réparent des véhicules, financent des drones, soignent, approvisionnent les unités.
Selon des analyses publiées en 2024 et 2025, plus de 70 % des Ukrainiens ont participé d’une manière ou d’une autre à cet appui logistique, médical ou matériel aux forces, ce qui montre que l’arrière devient une zone de mobilisation sociale massive, sans forcément envoyer ces gens au front.
Autrement dit, “soutien à l’arrière”, ce n’est pas une zone tranquille : c’est une zone militarisée économiquement et humainement, mais pas forcément une zone de combat direct.
5. Et les pompiers, policiers, gendarmes, personnels d’hôpital ?
Gendarmerie : plus concernée que la moyenne. La gendarmerie nationale est une force armée au sens du Code de la défense ; elle fait donc partie des forces “actives” engagées en priorité (et dispose aussi d’une réserve).
Police nationale : très concernée sur le territoire. Pas une force armée, mais dotée d’une réserve opérationnelle mobilisable pour renforcer les services actifs (sécurisation, appui aux missions de police) ; rôle clef en maintien de l’ordre et sécurité intérieure en cas de crise.
Pompiers : en première ligne civile. La BSPP (Paris) est une unité militaire de l’armée de Terre ; le BMPM (Marseille) est une unité de la Marine nationale : ces corps sont engagés d’emblée comme forces actives sur leurs zones. Les SDIS (pompiers départementaux, pros/volontaires) sont dirigés sous ORSEC par l’autorité de police (maire/préfet) ; ils peuvent être mobilisés massivement, et le préfet peut réquisitionner personnes, biens, services en cas de nécessité.
Hôpitaux et soignants : critiques, donc mobilisés sur place. La réserve sanitaire (professionnels de santé volontaires) est mobilisable par le ministère/ARS, comme on l’a vu en 2020 ; au-delà, le cadre général de réquisition (défense/CGCT) permet d’assurer la continuité des soins. En pratique, cela signifie : rester à son poste sous obligation de service.
6. Et seulement après : l’extension à des civils non formés
Le dernier étage, c’est l’extension à des classes d’âge entières, y compris des gens sans expérience militaire préalable.
En Ukraine, sous loi martiale, tous les hommes de 18 à 60 ans sont considérés mobilisables, et la sortie du territoire leur a été interdite dès février 2022 pour maintenir cette capacité potentielle de rappel.
L’Ukraine a ensuite abaissé l’âge légal de mobilisation de 27 à 25 ans en avril 2024, afin de reconstituer ses effectifs après deux ans de pertes lourdes, avec l’objectif d’ajouter environ 50 000 nouveaux soldats aux forces.
C’est ce scénario-là (mobilisation territoriale large, contrôle des déplacements des hommes en âge de servir, pression sur les expatriés pour revenir) qui correspond à l’image que le grand public se fait de “l’appel massif”.
En Russie, la “mobilisation partielle” a officiellement ciblé des réservistes avec expérience, mais le texte du décret permettait en réalité d’appeler pratiquement n’importe quel citoyen mobilisable, hors certaines exemptions (par exemple certains travailleurs du complexe militaro-industriel considérés indispensables sur place).
En clair : l’appel massif des civils sans formation est un outil possible, mais c’est l’outil de dernier recours, quand les cercles précédents (active, réserve formée, anciens militaires, soutien stratégique intérieur) ne suffisent plus.
À quel moment vous devenez concerné, vous personnellement ?
Vous n’êtes pas mobilisé “parce que vous existez”.
Vous êtes mobilisé parce que vous rentrez dans une case utile pour l’État, à un moment précis de l’escalade.
Voici les situations concrètes où vous commencez à être concerné, avec (toujours) des exemples réels observés en Ukraine depuis février 2022 et en Russie depuis septembre 2022.
1. Vous êtes dans la réserve (ou vous l’avez été)
En droit français, il existe une réserve opérationnelle composée :
- de volontaires sous contrat (réserve opérationnelle dite de niveau 1, ou RO1),
- et des anciens militaires soumis à une obligation de disponibilité pendant 5 ans après la fin de leur service, appelée réserve opérationnelle de niveau 2 (RO2).
Traduction simple : si vous avez déjà porté l’uniforme récemment, l’État peut légalement vous rappeler en priorité pendant cette période de disponibilité. Vous faites partie du premier cercle après les militaires d’active.
C’est exactement ce qu’a annoncé Moscou le 21 septembre 2022 : la “mobilisation partielle” visait officiellement les réservistes ayant déjà servi dans l’armée russe et ayant une spécialité militaire. Objectif annoncé : 300 000 personnes.
En Ukraine, dès le début de l’invasion russe en février 2022, les premières vagues ont rappelé les réservistes et vétérans déjà formés (anciens du Donbass), avant d’élargir.
Conclusion : si vous avez déjà eu un numéro d’unité, une affectation, un chef direct et une spécialité identifiée, vous êtes rappelable plus vite qu’un civil sans expérience militaire.
2. Vous avez une compétence exploitable immédiatement
Même sans passé militaire, certaines compétences vous rendent “utilisable” très vite : conduite poids lourd, mécanique lourde, maintenance d’équipements critiques, énergie (réseaux élec / eau), santé (infirmier, aide-soignant, médecin), transmissions / réseaux / cybersécurité, logistique.
Dans la pratique, ces profils ne sont pas toujours envoyés en première ligne ; ils sont mobilisés pour maintenir l’outil de guerre : transporter du matériel, réparer les véhicules, assurer les réseaux, soigner, tenir l’intendance.
Ce schéma est visible en Ukraine : la loi de mobilisation ne concerne pas seulement les forces armées ; elle organise aussi la mise à disposition des ressources humaines et matérielles nécessaires au fonctionnement des infrastructures vitales (transport, énergie, soins, production).
En droit français, le Code de la défense prévoit la réquisition de personnes, de services, de moyens de transport ou d’infrastructures pour les “besoins de la défense” : routes, rail, énergie, santé, eau potable, etc. L’autorité compétente peut imposer que ces compétences servent en priorité l’effort national.
Traduction concrète : vous continuez à faire « votre » métier, mais ce métier cesse d’être facultatif. Il devient une obligation de défense nationale.
3. Vous êtes jugé indispensable à votre poste civil
Être “trop utile ici” peut, paradoxalement, vous empêcher d’être envoyé ailleurs.
Exemples typiques : personnel réseau électrique, agents eau potable, soignants, techniciens télécom, conducteurs indispensables au transport militaire ferroviaire / routier, maintenance d’infrastructures critiques.
En France, en cas de réquisition, l’État peut exiger que ces personnes et ces moyens restent disponibles pour la défense (assurer l’acheminement militaire sur le rail, maintenir les flux logistiques, garantir les services vitaux).
En clair : vous n’êtes pas “protégé parce que civil”, vous êtes “fixé sur place parce que critique”. On vous maintient là où vous êtes le plus utile au fonctionnement du pays.
Côté Ukraine, c’est visible depuis 2022 : l’arrière n’est pas laissé “au volontariat”. L’économie, les transports et les soins sont intégrés dans l’effort de guerre sous régime de loi martiale. Les autorités ont aussi restreint les sorties du territoire pour les hommes mobilisables afin de conserver ces ressources humaines sur place.
4. Vous êtes un civil sans expérience militaire et sans compétence critique identifiée
Ici, on parle de la majorité de la population : pas d’expérience militaire récente, pas de statut réserviste, pas de fonction technique vitale pour l’infrastructure nationale.
Vous n’êtes pas dans la première vague.
En Russie, le discours officiel disait “réservistes expérimentés uniquement” en septembre 2022, mais le décret signé par Vladimir Poutine permettait en réalité d’appeler largement, à l’exception de certains personnels considérés indispensables dans le complexe militaro-industriel. Cela montre que juridiquement, l’État peut élargir la cible au-delà du cœur “pro”.
En Ukraine, dès février 2022, la loi martiale a interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le territoire : l’État les garde disponibles comme réservoir humain potentiel. Cela ne veut pas dire que tous sont envoyés au front immédiatement ; l’incorporation forcée dans l’armée ne concerne légalement que des tranches d’âge plus restreintes (27 ans puis 25 ans après la réforme d’avril 2024).
Mais attention au timing : dans les faits, je le répète, l’Ukraine a d’abord utilisé ses forces actives, ses réservistes et ses vétérans du Donbass, avant d’aller chercher plus large chez les civils.
Ce n’est pas “on prend tout le monde tout de suite”, c’est “on élargit par cercles de plus en plus larges selon les pertes et les besoins”.
5. Le cas extrême : l’appel massif d’une classe d’âge
Scénario le plus lourd : l’État décide de mobiliser une tranche d’âge entière, par exemple tous les hommes d’une génération spécifique, pour combler un déficit humain majeur.
Ce type d’appel de masse ne se déclenche pas pour une simple tension diplomatique : il arrive quand le pays considère que sa survie ou l’intégrité du territoire est directement menacée, et qu’il doit générer du volume humain rapidement.
Autrement dit, tant qu’on parle d’une montée de tension “classique”, la plupart des civils restent chez eux et assurent la continuité du pays.
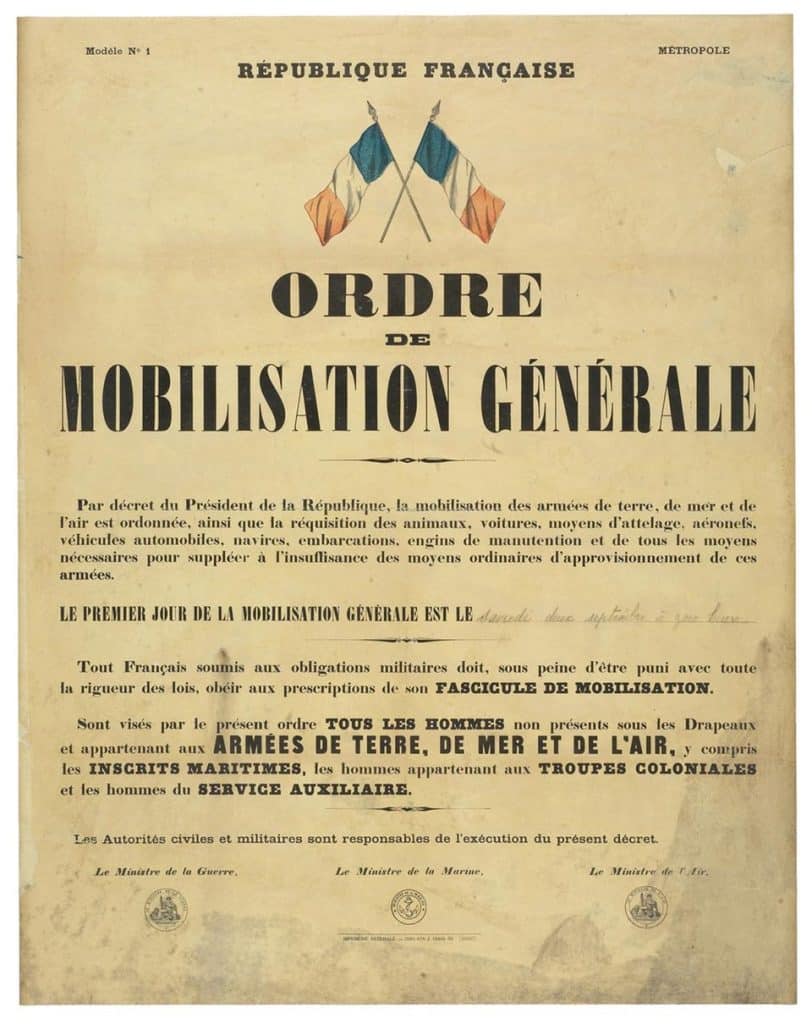
Est-ce que votre santé peut vous empêcher d’être mobilisé ?
Dans un contexte de guerre, l’aptitude médicale n’est pas évaluée comme en temps de paix.
Les États en guerre récente en Europe (Ukraine) ont durci les règles pour limiter les exemptions médicales et récupérer un maximum de monde apte à servir quelque part, pas forcément en première ligne.
Un point clé : l’Ukraine a supprimé la catégorie “apte partiellement”
Jusqu’en 2024, en Ukraine, il existait une catégorie médicale “apte de manière limitée / partiellement apte”, utilisée par des commissions militaires pour dire : cette personne n’est pas bonne pour le combat direct, mais pourrait servir dans certaines conditions.
Le 4 mai 2024, la loi ukrainienne n°3621-IX est entrée en vigueur et a supprimé ce statut intermédiaire. À partir de là, la commission médicale classe les gens en deux groupes : “apte au service” ou “inapte”.
Conséquence directe : beaucoup de personnes qui se déclaraient “limitément aptes” doivent repasser une visite médicale d’ici 2025, pour être soit considérées aptes et donc mobilisables, soit totalement inaptes.
Traduction opérationnelle : l’État réduit les zones grises. Moins d’échappatoires médicales “confortables”, plus de gens considérés mobilisables, même si ce n’est pas pour le front direct.
Obésité
L’obésité sévère reste un facteur d’inaptitude dans de nombreux systèmes de conscription, parce qu’elle impacte mobilité, capacité cardio-respiratoire, risque métabolique et blessure sous effort.
Exemple chiffré hors Europe mais parlant : aux États-Unis, l’obésité (et les pathologies métaboliques associées) est devenue le premier motif médical de refus d’entrée pour les réserves / Garde nationale, et un facteur majeur de sortie anticipée. Dans certaines années récentes, plus d’un quart des candidats refusés l’étaient pour des raisons liées au poids, et l’obésité est décrite comme une menace directe pour la capacité de mobilisation de la réserve.
En Russie, lors de la mobilisation dite “partielle” de septembre 2022, Moscou a déclaré cibler “les réservistes ayant déjà servi et possédant une spécialité militaire”. En pratique, la presse russe et les observateurs ont relevé que des hommes avec des profils médicaux discutables (y compris surpoids marqué) ont été appelés, ce qui montre que quand l’État a besoin de volume, la barre médicale peut baisser.
Autrement dit, une obésité modérée ne garantit pas l’exemption. Une obésité sévère, qui empêche physiquement de servir (mobilité, souffle, risques aigus), reste un argument d’inaptitude, mais cet argument est de moins en moins accepté quand la pression humaine monte.
Diabète et maladies chroniques sous contrôle
Avant 2024 en Ukraine, certaines pathologies chroniques (diabète stabilisé, hypertension contrôlée, etc.) pouvaient conduire à des statuts “apte limité” ou “apte arrière”, c’est-à-dire : pas d’envoi en première ligne, mais possible affectation en soutien.
Depuis la réforme médicale d’avril / mai 2024, la commission n’a plus le droit de dire “apte mais seulement un peu”. Elle doit dire “apte” ou “inapte”. Comme je viens de l’expliquer précédemment, les personnes qui avaient été étiquetées “partiellement aptes” avant le 4 mai 2024 doivent repasser en commission médicale d’ici février 2025 (délai ensuite prolongé jusqu’en juin 2025) pour être reclassées.
Un diabète bien contrôlé peut ne plus suffire à écarter une mobilisation, mais peut quand même orienter vers un rôle arrière / soutien logistique plutôt qu’un rôle de combat direct.
Handicaps lourds, pathologies aiguës et inaptitude franche
Certains cas restent considérés inapte dans tous les systèmes : épilepsie non contrôlée, insuffisance cardiaque sévère, séquelles neurologiques lourdes, amputations majeures, déficits sensoriels sévères, troubles psychiatriques incapacitants.
Ces profils-là restent classés “inapte” par les commissions médicales ukrainiennes post-réforme.
Donc oui, l’inaptitude médicale totale existe toujours, mais elle doit être sérieuse, documentée et reconnue comme rendant le service impossible, pas seulement inconfortable.
Ce que cela implique pour vous
Le modèle “je suis un peu en surpoids / j’ai un traitement donc je suis tranquille” ne tient pas dans une logique de mobilisation de haute intensité.
Les pays en guerre ont tendance à fermer les portes d’échappement médicales intermédiaires pour transformer le maximum de citoyens en personnel mobilisable (combat ou soutien), et ne gardent l’exemption médicale totale que pour les cas lourds attestés par une commission.
En clair : une pathologie chronique bien suivie (diabète contrôlé, hypertension traitée, obésité modérée) vous expose encore à une mobilisation potentielle, au moins sur un rôle de soutien. L’inaptitude totale est désormais réservée aux incapacités majeures.

Âge, sexe : qui est ciblé en premier ?
On n’appelle pas toute la population d’un coup : on commence par les tranches d’âge et les profils jugés immédiatement “utilisables”.
France : quelle tranche d’âge, et hommes / femmes ?
En France aujourd’hui, il n’y a plus de service militaire obligatoire en temps normal.
L’“appel sous les drapeaux” est suspendu pour les Français nés après le 31 décembre 1978, mais la loi prévoit qu’il peut être rétabli “à tout moment” par une nouvelle décision politique si la défense nationale l’exige.
Le texte ne parle plus seulement des hommes : le service national moderne (recensement à 16 ans, Journée Défense et Citoyenneté entre 16 et 25 ans) s’applique aux jeunes Françaises et Français.
Juridiquement, la France peut décider d’appeler une classe d’âge en mobilisant aussi bien des hommes que des femmes, si elle vote ce rétablissement.
Ukraine : qui est retenu, qui est envoyé ?
Dès février 2022, sous loi martiale, l’Ukraine a bloqué la sortie du pays pour les hommes en âge de servir (globalement 18 à 60 ans) pour constituer un réservoir humain disponible.
Mais tout le monde n’est pas envoyé au front : l’incorporation forcée a ciblé d’abord les militaires déjà formés et les classes d’âge légales de mobilisation.
En avril 2024, l’Ukraine a abaissé l’âge légal de mobilisation de 27 à 25 ans pour récupérer environ 50 000 hommes supplémentaires, sans encore taper directement dans les 18–24 ans. Objectif : tenir la ligne sans vider complètement la génération la plus jeune.
Côté femmes : l’Ukraine n’a pas instauré une conscription massive féminine, mais les femmes ayant une formation médicale ou pharmaceutique (médecins, infirmières, pharmaciens) doivent désormais être enregistrées pour un emploi potentiel dans le système de défense, y compris soutien médical.
Donc : en Ukraine, la pression principale porte sur les hommes 25+ mobilisables, mais les femmes soignantes sont intégrées comme ressource stratégique de soutien.
Russie : qui a été touché en premier ?
Le 21 septembre 2022, Moscou a annoncé une “mobilisation partielle”. Le ministre de la Défense a dit viser 300 000 “réservistes” : des hommes ayant déjà servi, possédant une spécialité militaire.
En clair, la priorité a été mise sur des hommes souvent déjà passés par l’armée, y compris au-delà de la vingtaine, plutôt que sur des étudiants de 18 ans sans expérience.
Les femmes n’ont pas été mobilisées en masse pour l’infanterie ; elles apparaissent surtout en soutien (santé, logistique).
On voit le même schéma partout : d’abord les hommes déjà formés, ensuite seulement l’élargissement. Les femmes sont sollicitées dans les fonctions de soutien, pas comme première vague de combat.
Réquisition civile : servir sans uniforme, est-ce possible ?
Oui.
Un État peut vous obliger à continuer votre métier civil, non pas “pour l’entreprise”, mais pour la défense nationale.
C’est ce qu’on appelle la réquisition.
Ce que veut dire “réquisition”, concrètement
En droit français, le Code de la défense permet à l’État (Premier ministre, ministères concernés, préfets) de réquisitionner pour répondre aux « besoins de la défense nationale » :
- des personnes,
- des biens,
- des services,
En clair : on peut vous dire “vous devez rester à ce poste et assurer cette mission, parce qu’elle est considérée comme stratégique pour le pays”.
Ce n’est pas du volontariat, ce n’est pas une faveur à l’État, ce n’est pas une astreinte classique : c’est une obligation légale liée à la défense nationale.
Qui peut être réquisitionné ?
Les réquisitions visent en priorité les secteurs qui permettent au pays de continuer à tourner en situation de crise grave :
- énergie (électricité, réseaux, carburant),
- eau potable / assainissement,
- transports routiers / ferroviaires stratégiques, logistique de fret, carburant, maintenance des véhicules lourds,
- télécommunications et réseaux, soutien cyber, protection des systèmes d’information,
- santé (soins, hôpitaux, flux de patients, soutien sanitaire d’urgence),
- sécurité civile (pompiers, secours),
- production / réparation utile à l’armée (ateliers, mécanique lourde, munitions, équipements).
Exemple français très clair : les sapeurs-pompiers militaires de Paris (BSPP) et de Marseille (BMPM) relèvent directement de l’armée (Terre et Marine). Ils sont considérés comme forces engagées d’emblée sur leur territoire en cas de crise majeure.
Autre exemple : les soignants. Il existe une réserve sanitaire mobilisable par l’État pour renforcer les hôpitaux, et au-delà de ça, l’État peut imposer la continuité du service hospitalier et réquisitionner des personnels de santé sur des fonctions critiques.
Donc, si vous êtes infirmier, anesthésiste, technicien réseau électrique, conducteur poids lourd stratégique, opérateur eau potable, agent rail fret militaire, vous êtes considérés comme “structure portante”. Vous n’êtes pas envoyés au front en premier. Vous êtes verrouillés à votre poste, sous obligation.
Ce que ça change pour vous par rapport à une mobilisation “classique”
- Mobilisation militaire = vous êtes intégré dans une unité armée.
- Réquisition civile = vous restez là où vous êtes, mais votre activité devient officiellement une mission de défense nationale.
En Ukraine, ce schéma est visible depuis février 2022 : la loi martiale ne concerne pas uniquement les forces armées, elle organise aussi l’économie, les transports, l’énergie et les soins comme partie intégrante de l’effort de guerre. Les hommes en âge de servir ont été interdits de sortie du territoire (18–60 ans) pour garantir ce vivier humain, que ce soit pour les forces ou pour le soutien intérieur.
C’est important : dans un scénario réaliste, la majorité des civils ne deviennent pas fantassins. Ils deviennent indispensables au maintien du pays en état de fonctionner, et n’ont plus la liberté de dire “j’arrête”.
Est-ce que vous pouvez refuser ?
En France, une réquisition légalement prononcée est une obligation : le refus peut être sanctionné (pénalement et/ou administrativement selon la nature de la réquisition et le cadre juridique utilisé).
En Ukraine sous loi martiale, refuser l’ordre de mobilisation ou contourner l’obligation de rester sur le territoire (par exemple en quittant illégalement le pays alors qu’on est dans la tranche d’âge mobilisable) expose à des poursuites. Les autorités ont renforcé les contrôles physiques et numériques pour traquer les “évasions”.
Autrement dit : la réquisition civile n’est pas “venez aider si vous voulez”, c’est “vous êtes requis parce que votre poste est jugé vital pour l’ensemble”.
Pourquoi ça vous concerne plus que le scénario “on vous met un fusil en main”
Parce que statistiquement, sur un pays entier, il y a beaucoup plus besoin de faire tourner les réseaux (énergie, eau, transport, hôpitaux, communications) que d’envoyer chaque individu en première ligne.
Regardez l’Ukraine : au-delà de l’armée visible, l’effort de guerre repose aussi sur une mobilisation de soutien massif (logistique, réparation, soins, transport). C’est cette couche qui empêche l’État de s’effondrer, pas uniquement l’infanterie de contact.
C’est exactement ce scénario qui toucherait le plus grand nombre de civils en France dans une crise majeure : pas l’assaut, mais la continuité vitale du pays sous contrainte légale.
Conclusion : sans panique, mais pas les yeux fermés
On n’envoie pas “toute la population” au front du jour au lendemain.
On commence toujours par les forces déjà formées (militaires d’active, réservistes, anciens militaires), puis seulement après on élargit.
Ensuite viennent les soutiens jugés indispensables : santé, énergie, transports, réseaux, logistique, maintenance. Ces profils peuvent être réquisitionnés pour continuer à faire tourner le pays, sur place, sous obligation.
Le scénario où l’État appelle une tranche d’âge entière de civils sans expérience existe, mais c’est un dernier recours politique, pas la première étape.
Alors… et vous, vous êtes concernés ?…









